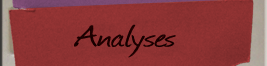Un extra-terrestre débarque sur Terre, accompagné de son gros robot cyclope qui lance des rayons mortels (ah ben oui, c’est de la science-fiction de 1951). Alors qu’il vient délivrer un message de paix, il est chaleureusement accueilli par une joyeuse bande de militaires farceurs qui lui collent une balle dans le buffet.
Mais parce qu’il en faut plus pour arrêter Klaatu (c’est son nom), le bonhomme échappe à la garde des farceurs susmentionnés et décide de se balader au milieu des terriens dans son beau costume d’humain tout neuf, pour apprendre à les connaître et, accessoirement, savoir si cette espèce représente effectivement un danger pour la galaxie qu’il faudrait éradiquer.


Ça, c’était plutôt la version 1951. Aujourd’hui, curieusement, Klaatu nous revient un peu plus radical. Ce qui faisait le charme de l’extra-terrestre original, c’était son humanisme démesuré. Klaatu a une foi inébranlable en tout ce qui fait preuve d’intelligence et d’empathie. S’il ne préfère pas perdre son temps avec ceux qui n’en valent pas la peine (cf. « Je ne suis impatient que vis-à-vis de la stupidité, c’est le plus grand fléau de votre espèce »), il n’en demeure pas moins confiant dans la capacité à la paix que les humains pourront développer, éventuellement, un jour, peut-être…
Keanu « Klaatu » Reeves, aujourd’hui, manque de cette profondeur. On perd même la magie qui nous laissait imaginer comment Klaatu avait pu s’évader par exemple (en 2008 on n’imagine plus on a besoin que tout nous soit expliqué dans le détail). Le personnage moderne est navrant de vacuité, il n’est réduit qu’à sa fonction et on dirait que toute tentative pour développer une opinion personnelle le ferait transpirer à grosses gouttes. Chaque fois que les caricatures qui lui servent d’interlocuteur le mettent en porte-à-faux, il avance la mission qui lui a été confié et c’est comme ça ce n’est pas sa faute.

Keanu Reeves jouant Keanu Reeves
Cette mission, c’est un génocide écologique. Les militants écolos les plus extrémistes n’y avaient pourtant pensé à celle-là (enfin j’espère). L’humanité détériore la planète et donc, pour la sauver, il suffit d’éradiquer l’espèce humaine. Klaatu est donc venu pour parlementer avec… avec personne en fait puisque le processus de destruction est déjà lancé quand il arrive et qu’il n’estime personne digne de parler pour l’humanité. Je rappelle que l’ancien Klaatu, celui de 1951, discutait vraiment avec les humains et cherchait une solution pacifique au cœur de la guerre froide.
C’est en effet le contexte historique qui a fait de chaque film son sujet central : un message de paix pendant la guerre froide (1951), et un message écologique culpabilisant aujourd’hui (2008). Ce phénomène intéressant est présent dans bon nombre de réadaptations, particulièrement en science-fiction. L’exemple le plus célèbre, pour ceux que ça intéresse, étant sans doute la longue saga des body-snatchers, qui retranscrivent, chacun dans sa décennie, les peurs de son époque.

"Je crois que mon tailleur se fout de ma gueule !"
« The day the Earth stood still » était un film pacifiste dont la réussite tient essentiellement à son personnage central et au message qu’il délivre, dans un contexte historique particulièrement tendu (rappelons-nous que tous les américains s’attendaient alors à une troisième guerre mondiale d’un moment à l’autre).
Le message de la version 2008 est très différent, et il est même franchement douteux. Je m’explique : Klaatu et son peuple ont décidé d’exterminer la race humaine pour protéger la Terre et le reste de la galaxie d’une espèce irresponsable et belliqueuse. On nous explique ainsi qu’une civilisation, du haut de sa supériorité auto-affirmée, a le droit de s’approprier l’avenir d’une autre, « for the greater good » comme on dit là-bas. Ça ne vous rappelle rien ? Oui c’est un concentré de politique extérieure américaine contemporaine !Bien sûr on va me répondre que c’est du 2e degré, et que le but est de dénoncer cette politique-là. À cela je répondrai que si c’est le cas, c’est tellement subtil que presque tout le monde passera à côté. Ma conclusion reste donc la même : c’est carrément dangereux de véhiculer ce genre de message !
"Klaatu Verada Nikto"
Bruce Campbell