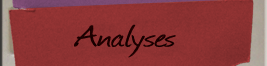« Coluche - l’histoire d’un mec » : voilà encore un exemple caractéristique de biopic « sur le fil », entre fiction et documentaire. Il s’agit bien d’une fiction car, à l’exception des moments publics (les séquences de spectacles sont reproduites au millimètre et à l’intonation près), l’intégralité du récit est reconstitué. Bien sûr tout cela est basé sur un travail journalistique, mais il n’empêche que ça reste du domaine de la fiction.
 Pourtant l’approche stylistique de ce film est bien celle d’un documentaire. La structure narrative en puzzle, composition hachée d’éléments achronologiques, nous donne une impression de moments pris sur le vif, ou sélectionnés comme les séquences choisies d’un documentaire.
Pourtant l’approche stylistique de ce film est bien celle d’un documentaire. La structure narrative en puzzle, composition hachée d’éléments achronologiques, nous donne une impression de moments pris sur le vif, ou sélectionnés comme les séquences choisies d’un documentaire.Le traitement du sujet (la candidature de Coluche aux présidentielles de 1981 et la campagne qui s’en est suivie) est brut, sans concession, parfois dur envers l’icône elle-même. Ce parti pris est celui de la représentation du vrai, loin des biopics qui nous présente un personnage semi-légendaire qui n’a aucune substance réaliste (cf. biopics américaines de base).
« Coluche » est aussi le portrait d’une époque, celle de la France des années 1980, dont les préoccupations seront toujours présentes presque 30 ans plus tard. Aucun spectateur ne manquera de se poser la question : que dirait ou ferait cet homme aujourd’hui ? Ce regard sur le passé est aussi un moyen de mettre en lumière les changements que la France a subie ces dernières décennies.
Une double écriture très fine, pas très poussée mais du coup très légère, sous-tend tout le récit. La scène qui m’a le plus marqué est un très bel exemple de double langage : une petite fille qui marche, un petit garçon caché derrière un mur qui lui fait peur quand elle passe, par surprise ; et le dialogue suivant :
« Ah c’est malin !
– oh ça va, c’était juste une blague…
– ouais… juste une blague… »
Vraiment, c’était juste une blague ?
"On croit que les rêves, c'est fait pour se réaliser. C'est ça, le problème des rêves : c'est que c'est fait pour être rêvé."
Coluche